par Elsa Marchitto
Dernier National Book Award, Jesmyn Ward poursuit la dénonciation du racisme à l’encontre des populations noires aux Etats-Unis et confirme son engagement. Dans la lignée de ses œuvres précédentes qui mêlent témoignage personnel et dénonciation sociale, Le chant des revenantsjaillit comme un cri d’alerte à l’endroit d’un pays paralysé par des inégalités inébranlables.
Jesmyn Ward, Le chant des revenants.Trad. de l’anglais (USA) par Charles Recoursé. Belfond, 285 p., 21 €
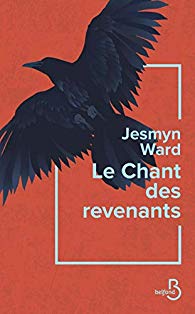
« J’aime bien penser que je sais ce que c’est la mort », affirme dès le début Joseph du haut de ses douze ans. La mort, omniprésente, presque personnifiée par la narration de chapitres entiers par un fantôme, s’impose à nous comme Jesmyn Ward l’a subie plus jeune. La perte de son frère dans de terribles circonstances alors qu’elle n’était qu’étudiante s’ajoute au meurtre accidentel du frère de Leonie, la mère de Joseph et enchevêtre décès imaginés et témoignages personnels. La frontière entre fiction et expérience, perpétuellement poreuse, lie intimement l’écrivaine à son œuvre. Le chant des revenants semble s’imposercomme la succession de son premier National Book Award, Bois sauvage, qui s’attache à rendre unvibrant hommage aux victimes oubliées du racisme lors de l’ouragan Katrina. Également héritier d’un récit mémoriel et vivement engagé, Les moissons funèbres, qui exorcise à nouveau les souffrances et injustices subies à cause de sa couleur. Dans une atmosphère qui confine au fantastique, Jesmyn Ward forge ses mémoires dans son combat et assume son message humaniste.
Inspirée par son propre vécu, de ses expériences traumatiques, Jesmyn Ward va faire parler ces « invisibles ». Au centre de la décomposition d’une famille noire américaine, elle va étayer sa critique d’une société en dérive. Ostensiblement, le rôle des parents s’effrite au profit de figures de remplacement – les grands-parents – et esquisse des relations familiales complexes. L’épicentre même de l’intrigue, un road-trip improvisé pour aller récupérer le père, Michael, qui sort de la prison la plus proche, s’éloigne en réalité d’un simple voyage initiatique. Au-delà de la joie de sa sortie, se déploie surtout la volonté de resserrer des liens familiaux distendus. Le rapprochement de chacun des membres apparait alors comme une pièce fondamentale qui manque dans la vie des personnages. On espère que le comblement de ce vide s’apparentera au sésame ultime : l’ascension sociale. Amenés sur les sentiers du rêve américain, où l’acharnement au travail permet de s’extirper de sa condition sociale, on attend maladroitement ce qui permettra l’indépendance financière, morale ou encore affective des parents vis-à-vis de leurs aînés. Plus idéaliste encore, on se languit du moment où le mécanisme de promotion sociale aidera cette nouvelle génération à se détacher de sa condition et des inégalités qui l’accompagnent. Néanmoins, l’issue de ces péripéties aventureuses par un retour à la maison natale témoigne de l’inaccessibilité de cette ambition pour cette partie de la population. Derrière une intrigue aux enjeux finalement peu déterminants, nous comprenons que la finalité de l’œuvre réside dans la mise en lumière de la précarité réelle d’une partie de la société américaine connue, mais marginalisée par une forme de déni collectif.
Si, face à la vie difficile des personnage, on est comme saisis par un fol espoir, la réalité d’un monde marqué par un héritage socio-économique accablant et profondément enraciné s’impose. Perpétuelle, la lutte des personnages, coincés entre leurs espérances vaines et la fatalité de leur condition, la mélodie du chant d’un frère qui rassure sa sœur s’inscrit dans un thème récurrent, en ricochet au titre original Sing, unburied, sing. Ce cycle mélodieux s’oppose au caractère sombre et inquiétant de ce qui demeure « unburied » qui ouvre à des interprétations multiples : fantômes qui hantent la famille, deuil d’une mère pour son fils jamais accompli… Sans explicitement évoquer la religion vaudou, les voix spectrales et autres rites surnaturels témoignent d’un héritage profondément ancré dans les personnages. La puissance de la transmission culturelle poursuit les enfants comme le fardeau de pouvoir communiquer avec les morts, comme lorsque Joseph tente désespérément de se débarrasser du fantôme d’un ami d’enfance de son grand-père. La traque perpétuelle ressasse un lugubre passé et renvoie l’image du temps qui passe, mais uniquement dans sa dimension physique. Si la mère perçoit le passage de son fils àl’adolescence ou encore la beauté troublante de sa fille, ces traces corporelles sont les seuls témoins du caractère évolutif de la vie. L’angoissante stagnation de situations et d’aspérités de la part des personnages nous plonge dans un spleen d’impuissance. Jesmyn Ward ne cherche pas seulement à dénoncer les inégalités existantes mais leur genèse. L’impossibilité d’une évolution comme une justice sociale biaisée déresponsabilise les personnages du livre quant à leur mode de vie et expose surtout la nécessité d’un changement global du fonctionnement de nos sociétés.

Immergés dans un environnement de précarité constante, tous les éléments semblent converger à l’encontre des personnages. Si le racisme, à travers l’absence de liens entre les petits-enfants noirs et leurs grands-parents blancs, instaure une stigmatisation physique, ce mur dissimule un plus grand clivage entre deux milieux sociaux. Isolés et abandonnés par leur pays, les afro-américains semblent devoir se cantonner à un monde en ruines. Seule alternative à la vie en banlieue, la prison. Omniprésente, transgénérationnelle, presque mystique, elle s’apparente à un chemin inévitable, bercé par la drogue et la sexualité. Ces deux échappés se mêlent et s’emmêlent pour tenter de fuir l’austérité du quotidien et créent un sentiment de confusion entre réconfort et autodestruction. Ce sombre capharnaüm est toutefois contrebalancé par l’amour qui subsiste entre certains personnages. Derrière la tendresse des interactions fraternelles ou encore la complicité des grands-parents avec leurs petit-enfants, Jesmyn Ward semble justifier les raisons de la survie de ses personnages en intégrant en filigrane un message d’amour universel. Loin de s’inscrire dans un idéalisme naïf, ces bulles d’apaisement apportent une légèreté aux mots. Elles dressent une image moins péjorative de ces citoyens, par rapport à celle habituellement véhiculée, et témoignent de l’optimisme de la romancière pour le changement qu’elle souhaite. Sa démystification s’emploie à prouver l’absurdité de la marginalisation. Contre le racisme, Jesmyn Ward prône la mixité des humains de toutes couleurs, tous milieux, tous espoirs. Une lutte qui rappelle que le combat humaniste n’est toujours pas gagné, malgré la vaste littérature de défense des droits humains qui la précède. A l’instar du Beloved de Toni Morrison et de ses fantômes qui manifestent du poids du passé esclavagiste, Jesmyn Ward aiguise ses mots comme une véritable arme. Par un lexique âpre, une syntaxe heurtée, elle dépeint rigoureusement le quotidien de personnages qui oscille entre une haine de soi autodestructrice et la violence de la révolte. Enfants battus, bavures policières, lynchages et autres injustices se présentent comme une norme qui nous amène naturellement sur le chemin d’une réflexion indignée. Publié aux États-Unis un an après l’élection de Donald Trump, cette entreprise, aux confins du roman et de la sociologie, soulève de véritables enjeux sociaux, sans néanmoins imposer de réponse univoque. Par cette double approche, Ward modernise l’engagement par la littérature, reconnaissant et s’affranchissant d’un héritage politique complexe. Inscrit dans un Sud violent qui ne se dépêtre pas de son héritage ségrégationniste, elle semble vouloir croire à un changement nourri par la profondeur d’une mémoire

