par Elias Arndtzén
Dans son troisième roman Maudit soit l’espoir, l ́écrivain turc Burhan Sönmez raconte les derniers jours de quatre détenus politiques dans une prison souterraine d’Istanbul. Au cours du récit, où s’entremêlent souvenirs, contes de fées et discours philosophiques, s’esquisse une image nostalgique et déchirante de la ville et de ses habitants. Face à la souffrance et à la terreur, une quête de vérité.
Burhan Sönmez, Maudit soit l’espoir. Trad. du turc par Madelaine Zivaco. Gallimard, 288 pages, 21.50 €
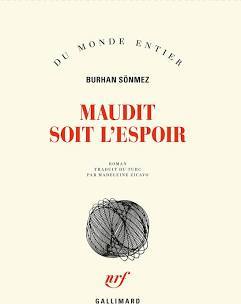
Écrit dans la Turquie d’Erdogan, toujours plus autoritaire, où le moindre écart du discours officiel conduit à la prison, il est tentant de lire ce roman comme un réquisitoire contre l’oppression et la brutalité du régime actuel. D’autant que Burhan Sönmez, avocat des droits de l’homme pendant la guerre civile des années 90, pourrait bien se lancer dans une telle entreprise. En 1996, il échappe de peu à une tentative d’assassinat par la police et s’exile pendant de longues années. Pourtant, si la répression et la brutalité policière se font sentir au plus haut point, en fait le roman s’éloigne de l’actualité politique.
Le récit, épuré à l’extrême, se limite à une cellule et à quatre détenus. Impliqués d’une manière ou d’une autre dans des activités révolutionnaires, ces hommes se dissimulent leur identité les uns aux autres. Dans l’obscurité et le froid, sans aucun contact avec le monde extérieur, ils subissent la torture aux mains d’interrogateurs féroces et impitoyables. Pour l’essentiel, la nature du régime politique comme celle de la lutte clandestine demeurent floues. Aucun leader, événement ou idéologie n’est évoqué. Marquée par l’oppression et la résistance révolutionnaire, l’action du roman pourrait se dérouler dans chacune des périodes autoritaires de l’histoire turque, la période actuelle comprise. Alors, loin de formuler une critique politique, l’auteur confère aux horreurs de la prison une portée universelle, comme si l’enfermement et la brutalité étaient une fatalité pour la Turquie.

Pourtant, les prisonniers ne désespèrent pas de leur situation. Au contraire, tout au long du roman, ils ne cessent de s’évader à travers la mémoire, l’imagination et le rêve. En chuchotant pour tromper la vigilence du gêolier, ils se confient des histoires, se posent des devinettes et parlent du monde extérieur. Ensemble, à l’intérieur de la cellule, ils construisent une vision resplendissante d’Istanbul, avec ses couleurs, ses paysages et ses jouissances. Ils vont même jusqu’à rêver ensemble, comme lorsqu’ils embarquent sur un bateaunavette ou partagent un repas festif sur un balcon donnant sur la Bosphore.
Inspiré du Décaméron de Boccace, le récit se subdivise en dix jours, durant lesquels chaque prisonnier dans la cellule se fera narrateur. Le Docteur, un homme âgé, aime parler de la beauté de la ville avec ses minarets et ses coupoles, ses ruelles et ses bazars, tout en déplorant les ravages de la modernisation urbaine. Demiray l’Étudiant, très jeune, repense à son enfance pauvre, à sa mère surmenée par le rythme de cette ville déchaînée, sans continuité ou empathie humaine. L’un se fait arrêter à la place de son fils militant, l’autre se joint luimême aux révolutionnaires. Kamo le Barbier, en revanche, ne croit pas en la politique. Avec une enfance malheureuse et un mariage raté derrière soi, il voit tout en noir et s’isole des autres. Enfin, il y a Küheylan Dayı, un vieux campagnard vaguement lié à la guérilla kurde qui rêve d’Istanbul depuis l’enfance.
D’une certaine manière, ces portraits manquent de nuance et de profondeur. Les limites que s’impose le roman ne permettent pas vraiment de faire agir les personnages, ni d’entrer dans les détails de leurs vies passées afin de développer leurs personnalités. Le manque de nuances qui en découle donne aux sentiments et aux réflexions des prisonniers quelque chose d’abstrait et de chimérique, qui les rends moins convaincants. Malgré cela, les personnages de Kamo le Barbier et de Küheylan Dayı suscitent un vif intérêt par la divergence de leurs philosophies personnelles.
Pour Kamo, la vie à l’extérieur n’inspire plus que dégoût. Au lieu de rêver, il se renferme sur luimême : « Si chaque être possédait en lui un gouffre obscur, Kamo attendait au bord de son propre gouffre. Il contemplait un vide infini et ne voyait que de l’obscurité ». Il affirme que l’homme demeure un loup pour l’homme, la société un jeu de dupe effrayant et tout progrès illusoire. Selon lui, seuls les tortionnaires « n’ont pas recours au mensonge. Ils ne dissimulent pas la vérité. Ils s’approprient le mal sans hésiter ». Ce qui le fait désespérer de la vie, pourtant, ce n’est pas une vérité atroce mais un amour méprisé. Küheylan Dayı, à l’inverse, témoigne d’une fascination inépuisable pour la vie à l’extérieur, dans cette ville qui nourrit ses rêves depuis l’enfance, mais aussi d’une conscience de ses malheurs et de ses déceptions : «Tout le monde évoquait la beauté d’Istanbul, personne n’arrivait à y vivre heureux. L’équivoque, l’égoïsme et la violence occultaient le beauté de la ville ». Ce vieillard, originaire de la campagne, voit dans la ville toute la créativité et le potentiel de l’imagination humaine. «La ville est le pays du rêve, disait mon père, elle porte d’infinies possibilités et l’homme n’est pas une partie de la nature mais son artisan. Il construit, fonde, crée». Pourtant, Istanbul se dégrade, car les Stambouliotes choississent de s’abimer dans leurs illusions et de courir après des chimères au lieu voir la beauté qui les entourent. Si Kamo incarne le désenchentement et le désespoir, Küeyland Dayı personnifie l’imagination créative.

Les dix chapitres s’ouvrent par des histoires imaginaires que se racontent les prisonniers. Tantôt des contes de fées, tantôt des anecdotes, elles s’achèvent de manière souvent inattendue et burlesque. Par exemple, un voyageur se déclare prophète. Ses hôtes incredules exigent de voir un miracle et l’homme promet de faire chanter le mur du jardin, mais le mur s’exclame: «Mensonge ! Cet homme n’est pas un prophète!» Dans une autre fable, un jeune homme est poursuivi par une malédiction disant que pendant sa nuit de noces, il sera tué par un grand loup. Le moment arrivé, il se cache avec son épouse dans un coffre d’acier, entouré de gardes armés. Mais hélas! Le destin le ratrappe, car la jeune femme se transforme en loup entre ses bras et le dévore. En insistant sur le côté absurde, étrange et inattendu de la vie, ces histoires permettent aux prisonniers de voir au délà des murs de leurs cellule, de se libérer l’esprit face á une réalité implacable.
Le titre original du roman, “Istanbul, Istanbul”, fait de la métropole turque le centre du recit , mais en souligne l’ambivalence. La ville n’est pas que la pierre et le béton dont elle se compose, elle se multiplie en fonction des visions différentes qu’elle engendre chez ses habitants et se construit comme l’ensemble de leur rêves et leurs aspirations. Pour transformer Istanbul, il faut transformer sa manière de la percevoir, ou comme dit Küheyln Dayı : «Ce qui fait d’une ville une ville, c’est le regard de l’homme. Ceux qui portaient un beau regard sur la ville l’embellissaient, ceux qui la regardaient mal l’enlaidissaient. Le changement et l’enlaidissement de la ville étaient liés à ceux des hommes» Maudit soit l’espoir incarne donc une volonté de transformation, une transformation non de la politique, entreprise illusoire, mais des manières de voir le monde et d’imaginer l’avenir.

