par Antoine Chapel
Après la question de l’identité d’une civilisation européenne en déclin, Michel Houellebecq revient, avec Sérotonine, à ce qu’il sait faire de mieux : faire parler la France qui va mal.
Michel Houellebecq, Sérotonine. Flammarion, 352 p., 22 €
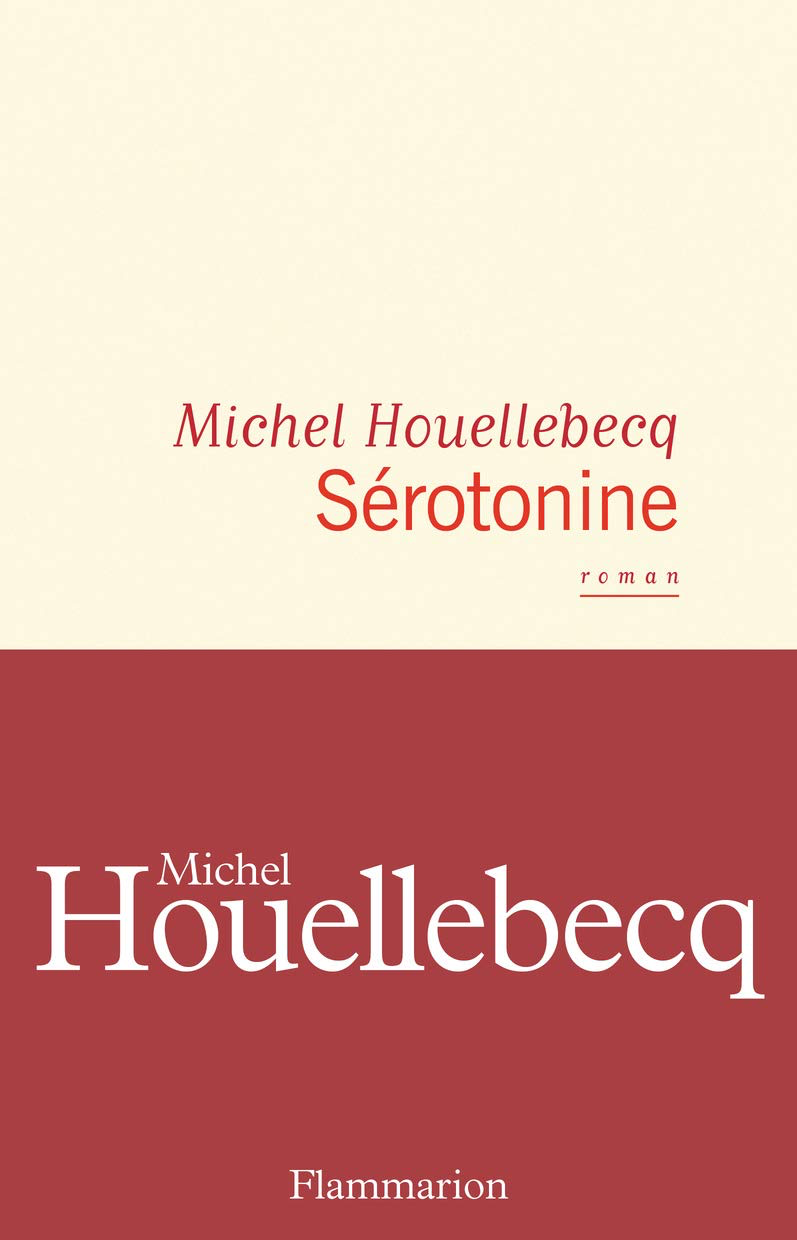
Florent est un ingénieur agronome. Reconnu pour sa haute compétence en matière de rédaction de rapports sur, par exemple, les abricots du Roussillon, sa vie est une succession d’échecs sur le plan des idées. Chroniqueur du déclin d’un pan de sa civilisation, il n’a aucun espoir : l’agriculture française est condamnée au suicide par balle.
Avant toute chose, il faut se débarrasser de Yuzu, sa compagne japonaise qui le rattache encore à une forme de vie en société. La solution est simple, immédiate : l’exil social, absolu. Quelques temps plus tard arrive la transaction qui installe le cadre d’un nouveau Faust. Ce contrat prend la forme du Captorix, un anti-dépresseur de dernière génération, qui reproduira au sein du corps du narrateur l’hormone de l’estime de soi, la sérotonine, artificielle reconstruction de la vie sociale. Le prix à payer pour cette indolore mise en retrait de la société : l’impuissance sexuelle qui, dans la mythologie houellebecquienne, n’est autre que le premier pas vers la mort physique. Le lecteur assiste alors à un déclin parallèle, dont l’issue morbide se fait plus certaine de page en page : l’ingénieur agronome avance d’un pas assuré dans sa dépression, rédigeant le testament de son impuissance et celui du monde agricole français.
Le récit de Houellebecq vise juste, et parvient à rendre séduisant un personnage profondément détestable. Tout repose ainsi sur un subtil équilibre entre qualités et défauts des personnages, qui piège le lecteur dans un jeu presque malsain. Mais le cadre de ce récit requiert l’acceptation préalable des prémices de Houellebecq, simplifications des comportements humains qui ne sauraient être entièrement convaincantes : notamment, l’homme et la femme sont caricaturés, particulièrement dans leur rapport à la sexualité. Pour faire simple, l’homme veut baiser, la femme veut être baisée. En dérivée, l’homme impuissant n’est bon qu’à mourir, et la femme, passé la ménopause, n’en est pas bien loin. La place de la femme a toujours été et reste, au fond, le foyer, et l’homme, le vrai, ne doit pas reculer devant une beauferie testostéronée de temps à autres. En s’urbanisant, en renforçant l’égalité entre hommes et femmes, la société occidentale se condamne à une décadence certaine. Voilà peu ou prou les idées qu’il est nécessaire de tolérer avant d’apprécier Houellebecq à sa juste valeur.

En revanche, Sérotonine ne présente pas le tableau d’une société occidentale qui s’effondre. Il s’agit bien là d’un roman de classe, celle du mâle de l’ancien monde qui n’a pas su s’adapter à la mondialisation, qui ne se sent pas parisien, qui a toujours vécu dans un monde où la femme est son égal. Ce mâle est, peut-être plus encore que par Florent, incarné par Aymeric, son ami d’études, l’aristocrate fermier abandonné par ses deux filles et par sa femme, partie avec un pianiste à la renommée internationale. Sérotonine est le roman des humiliés, des abandonnés, de ceux qui (et ils en sont parfaitement conscients) n’ont plus rien d’autre à faire que s’excuser du dérangement.
La force du roman réside en un subtil équilibre de sentiments suscités chez le lecteur. A de très nombreuses reprises, la tentation est là, forte, de condamner le personnage, de le renvoyer à ses échecs, de considérer que son comportement est et restera celui d’un connard macho d’un autre temps, brisant le pacte implicite fait avec l’auteur de respecter ses conditions. Lorsque Florent est à une flexion d’index d’abattre un enfant de quatre ans jouant au puzzle, on se dit que c’en est trop, on culpabilise même d’avoir pu ressentir la moindre empathie pour le monstre dépressif qu’il est devenu, on se dit que cette fois l’auteur est allé trop loin dans son mépris du genre humain. Mais en trois lignes, le personnage s’effondre sur lui-même, anéanti, et l’empathie reprend le dessus.
Si Sérotonine donne la parole au mâle ayant perdu au jeu de la mondialisation, c’est aussi le testament d’un monde agricole à l’agonie. Le narrateur ne se fait aucune illusion : il peut essayer autant qu’il voudra, la France de la campagne disparaîtra, incapable de lutter contre la production massive venant d’autres continents. Aymeric, la langue déliée par la vodka, réalise à son tour que le reste de sa vie se réduira à un choix : poursuivre son projet déjà condamné d’exploitation agricole, qui réduit d’année en année le terrain (dont il a hérité de sa famille) faute d’équilibre budgétaire, ou tout revendre et terminer sa vie dans un club d’aristocrates. Sérotonine est le roman de ceux qui se heurtent au système dans lequel ils vivent, impuissants du fait de leur minorité et de leur propre conscience d’être déjà au bout de la corde.
Le plus dur n’est pas de lire Sérotonine mais de déterminer si on l’a aimé ou abhorré. Houellebecq crée un cadre, celui de la campagne en déchéance, et y injecte son personnage, instaurant dès le début une complicité, un rapport direct avec le lecteur, tout en laissant la place au doute : lit-on Houellebecq ou Florent ? Au fond cela n’a pas grande importance : on rit, on réfléchit, on relativise : Sérotonine n’est qu’un roman, auquel il serait inapproprié d’attribuer une quelconque propriété prémonitoire relative aux gilets jaunes.
Si l’on choisit de lire Houellebecq, il faut jouer son jeu et en accepter les règles, si critiquables soient-elles. S’y refuser conduirait à une indignation permanente sans grand intérêt. Une fois le lecteur devenu complice, s’ouvre à lui un récit profondément réaliste, le chant triste du lien brisé entre homme et terre, et une parole donnée à ceux qui toujours se taisent.

