par Emmanuel Benhamou
Guerre, identité, Afrique. À partir de ce triptyque, David Diop explore un univers aussi fascinant qu’angoissant, accrocheur, et accrochant tout à fait le lecteur.
David Diop, Frères d’âme. Éditions du Seuil, 185 p., 22 €.
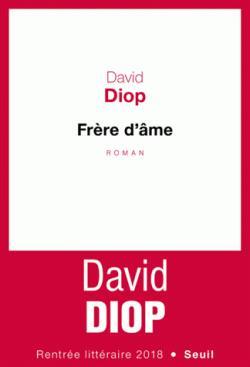
Novembre 2018. Les ennemis d’hier, amis d’aujourd’hui réconciliés, célèbrent le centenaire de l’armistice. Les manifestations mémorielles émaillent une année pleine de commémorations qui culminent par « l’itinérance » du président de la République. C’est peu dire que La Grande guerre a informé notre siècle, que notre nation s’est comme façonnée à partir de son basculement traumatique. Chacun retrouve des souvenirs scolaires, des images d’Épinal des poilus en pantalons garance. Penser l’histoire, ce n’est pas la même chose que de la vivre. Le grand Michel et ne s’y était pas trompé… Les jeunes jurés du Goncourt des lycéens sont sortis transformés de l’expérience que constitue la lecture de Frères d’âme, et l’ont récompensé. Le roman bouleversant de David Diop nous plonge dans les tranchées, « la terre de personnes », et la barbarie. Frères d’âme, c’est l’histoire de deux tirailleurs sénégalais, « plus que frères », que pourtant tout oppose, même les « orages d’acier ». Suite à la mort de son ami, Alfa, Medemba, se transforme en dévoreur d’âme, et tente de dépasser tous les clivages d’une identité dévastée, pour tenter de la bâtir, le tout dans une langue captivante, d’une pertinence rare.
Diop nous plonge directement dans son roman. La guerre, de la barbarie, mais aussi de l’amitié. Deux amis, des « plus que frères », Mademba Diop et Alfa Ndiaye servent la France. Au front, le premier, blessé, agonise. La vie et la mort, déjà. Alfa supplie son ami de l’achever. Que faire ? L’achever, avoir la mort de son ami sur la conscience, ou le laisser partir ? Une mort, mais qu’est-ce, par rapport aux dix millions d’âmes fauchées entre 14 et 18. Rien que de raisonner ainsi souligne l’inconfort auquel on est très vite confrontés. On essaie de s’en dégager, mais il revient, toujours. Comment le personnage d’Alfa peut-il, à partir de ce moment construire son identité, et basculer dans la barbarie ? Diop nous place avec brio dans une situation épineuse, embarrassante, mais qui nous attire tout autant que l’on tente de s’en délier. Diop s’attache aussi à la notion de destin et donne à son ouvrage une dimension quasi-messianique. C’est Jésus qui supplie un officier romain de l’achever lors de la passion, c’est dans le « vase sacré », le Graal, que cite Diop que se trouve son sang, et sa passion s’inscrit dans une logique de purification et de pardon. « Plus que frères », « terre de personnes », reviennent souvent. Une fois, oui, deux fois, allez, mais jusqu’à dix fois dans l’incipit, cela fait beaucoup. On pourrait en avoir assez, mais cela semble trivial de rappeler la justesse de ces propos, soulignant l’absence d’issue rationnelle à l’horreur, la barbarie intégrée, ou la naïveté pour vivre sainement l’atrocité, ou au moins le tenter. Cette mécanique lexicale est propre à cet ouvrage. On peut y voir une naïveté touchante, le psychanalyste en herbe y verra l’effet du basculement traumatique du héros, causé par le manque de la mère et l’horreur de la guerre. Ces répétitions et mécaniques linguistiques, bien que saisissantes à l’origine, ne tarderont cependant pas à lasser le féru de littérature classique.

Cependant, lors de la Première Guerre Mondiale, les miracles n’existent pas. Diop présente avec une lucidité et un regard détonant un univers que les arts n’ont cessé d’explorer. L’auteur y retravaille déjà des poncifs, l’horreur du front, la violence et la sauvagerie. Il se distingue des romans plus classiques sur cette période, comme Les Croix de bois de Roland Dorgelès, Orages d’acier, de Ernst Junger, ou même l’œuvre picturale de Jacques Tardi, C’était la guerre des tranchées. Diop s’intéresse au sort des tirailleurs sénégalais, grands oubliés de la mémoire du premier conflit mondial, que le Général Nivelle sacrifie au Chemin des dames, en 17. On voit à la condescendance des gradés à leur égard, qui les appellent « Chocolat », et les multiples frontières qui séparent les troupes métropolitaines des troupes coloniales. Mais Diop explore pleinement et parfaitement la folie et l’irrationnel. Il distingue la « folie temporaire », qui débute au sifflet du commandant, et se termine à la fin de l’assaut, de la « folie permanente ». Le fou temporaire « joue la comédie de la folie » dans le no man’s land, « la terre de personnes », alors qu’un « fou permanent », comme le protagoniste, est dangereux. Être un « fou temporaire », c’est maîtriser la folie, mais cela a-t-il même un sens ? Cette dualité rend terrifiants de longs chapitres, d’autant que Diop présente le front comme un théâtre. Un théâtre de l’absurde ? Une tragédie classique revisitée ? Avec une issue, la mort. Quelle barbarie peut-être plus folle que celle qui a décimé dix millions d’âmes entre 1914 et 1918 ? Cette tension rend le roman fascinant. De Barbusse à Dupontel, tous ont tenté de la résoudre. Mais Diop s’engage dans une démarche plus originale, couplant cela aux univers du personnage, guerriers, amicaux, psychologiques… Alors comme ça, la barbarie ne peut être comprise que d’un point de vue global ? Contestable, mais va. « La vengeance est un plat qui se mange froid », entend-on souvent. Pour venger la mort de son ami, Alfa se mue en un monstre froid, féroce et barbare, dévoilant une nouvelle. Alfa reste dans le no man’s landaprès les assauts, torture et coupe les mains des soldats allemands, tous aux yeux bleus. La froideur de ce bleu est glaçante et rappelle le goût de la loi du talion. L’auteur opère un basculement ; à partir de la quatrième mutilation, Alfa n’est plus perçu comme un tirailleur farouche, mais comme un véritable dëmm, un dévoreur d’âmes, animal. Ce basculement est représentatif du roman : la barbarie, les relations entre les soldats coloniaux et les autres, la folie temporaire et permanente…
Diop cherche et bouscule les points de friction de l’amitié entre Alfa et Mademba, dévoilant la complexité de l’amitié. Qui n’a jamais envié, admiré voire jalousé un ami ? Lorsqu’il traite de la fragilité des relations humaines, l’auteur se détache de la primitivité sanguinaire, trait majeur du roman. « J’aimerais être toi, mais je suis fier de toi », dit Mademba à Alfa. Si l’un est une force de la nature, l’autre est maigre et chétif, si l’un est beau, l’autre est laid. Si Mademba dispose de qualités intellectuelles et parle français, Alfa ne peut en dire autant. De ces tensions naît la relation entre les personnages ; de celle-ci naît aussi le désir de se dépasser, et de se prouver pour Mademba. Cette volonté le verra périr, lui qui voulait assaillir la tranchée adverse pour être aussi respecté. Diop présente une leçon de vie. Encore une fois, l’écriture de Diop s’impose comme une évidence dans la trame. Toutes les divergences sont dépassées par cette syntaxe… bien que la mécanique grince sur la fin.

David Diop nous fait découvrir enfin le Sénégal. On remonte ainsi aux origines, pour enquêter sur l’identité de ces personnages. L’originalité du roman tient à la juxtaposition de deux univers géographiques opposés. Diop nous présente le village, son organisation, les familles, traite aussi du désir, de l’apprentissage, mais toujours de la barbarie, avec l’enlèvement et la disparition de la mère du protagoniste. Cette barbarie sous-jacente sous-tend ce roman. Mais oui, la figure maternelle, si c’était elle qui détenait les secrets de l’identité d’Alfa ? La figure maternelle, la chaleur, l’amour, c’est le guide qui manque aux protagonistes. La femme est assez présente dans l’ouvrage ; l’écrivain compare la guerre à l’amour du capitaine, trompé par son rival Alfa, les tranchées sont comparées à une femme, quand le désir et l’attirance physique peuvent opposer les deux amis.
Diop écrit un roman plein, que l’originalité de la langue le rend spécifique. Originale, celle-ci l’est, assurément. Trop, sans doute. Si elle démarque le roman, on pourra en être lassé, bien qu’elle soit parfaitement adaptée à des pans de celui-ci. C’est donc avec cet O.V.N.I. que Nicolas Mathieu a concouru pour le Goncourt. Non identifié, c’est peut-être le problème de l’ouvrage de Diop. Riche, on peut en faire des multitudes d’interprétations. Est-ce un roman sur l’amitié ? Sur la guerre ? Sur la mère ? Sur quoi, finalement ? Et si la langue masquait ce flou, derrière une apparente simplicité d’analyse ?

