par Claire Feillet
Le dernier roman d’Éric Chevillard, L’explosion de la tortue, détonne dans le paysage littéraire contemporain. Son univers, étrange et déconstruit, invite néanmoins à un certain sens critique.
Éric Chevillard, L’explosion de la tortue. Minuit, 256 p., 18,50 €
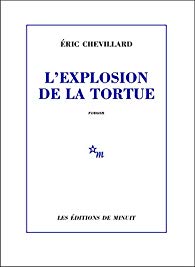
Que le lecteur ne s’en étonne pas, Éric Chevillard se livre, une fois encore, à des élucubrations déconcertantes. Devenues sa « marque de fabrique », il les assume allègrement et impose une originalité virulente. Son journal « extime », L’autofictif, arbore ce style saccadé et désorganisé auquel il tient tant. Il serait ainsi facile de cantonner cet auteur à la catégorie des plaisantins étranges : des ovnis de la littérature française qui n’en font qu’à leur tête, au mépris des codes et des critiques, et dont on ne comprend pas grand-chose. Son nouveau roman s’impose d’ailleurs par cette verve moqueuse et truculente. Les paragraphes s’enchaînent, les remarques, les histoires amusantes ou dramatiques, sans posséder de liens particuliers, de logique. On continue pourtant de lire, perplexe, dans l’attente d’une explication à ce tohu-bohu. Puis, les hypothèses surgissent. Les émotions diverses qui s’emparent du narrateur face à sa tortue écrasée (et ce jusqu’à la fin) pourraient correspondre aux égarements d’un homme constamment sur la défensive. Mais la mort de sa tortue le torturerait-t-il à ce point qu’il ait besoin d’expier sa faute à travers ce livre ? Venant d’Éric Chevillard, cela ne serait pas étonnant ! Mais ces digressions savamment orchestrées ne se déploient pas là par hasard, et le lecteur aurait tort de prendre cette incongruité à la légère.
Vraiment, il ne faut pas demeurer à l’étrange surface du roman. Tout lecteur consciencieux ne se laissera pas duper par cet humour absurde et poétique qui compare le craquement de la carapace à une hostie que le prêtre rompt. Derrière la verve, l’incongruité assumée, la provocation, se dissimule un profond questionnement de la littérature française. Chevillard organise une immense mise en abîme de la littérature qui semble ne pas avoir de fond. Il crée un second niveau de lecture et en profite pour glisser références et jeux de mots, tout en amorçant une réflexion subtile. Comme dans son précédent ouvrage, Du Hérisson, il s’empare de minuscules détails et leur procure un sens (comme le nom de la tortue, Phoebe). Au travers des pensées d’un tueur torturé, il poursuit une réflexion autour de l’auteur et de son œuvre, entamée dans L’auteur et moi. Ce « Crac » dans la carapace de l’amphibie ne serait-elle pas ainsi la fissure que Chevillard représente dans la littérature ?

Dans un entretien en 2001 avec Olivier Bessard-Banquy, pour la revue Europe, Éric Chevillard explique sa vision du roman : « On y raconte une histoire, avec un début (naissance) et un dénouement (mort), on y décrit une trajectoire nette. Tout est verrouillé. […] Quel que soit son contenu, si sulfureux soit-il, il ne saurait rien remettre en cause puisqu’il est un petit module de l’ensemble, un modèle réduit plus ou moins stylisé mais opérationnel et bien huilé du monde que l’homme s’est inventé (en se plaçant naïvement au centre). » Lui ne se considère pas comme romancier, mais se donne comme mission de démolir de l’intérieur les romans qu’il écrit, de les saboter comme réaction à la complaisance romanesque qu’il dénonce. Il multiplie donc les dérives, ne donne aucun repères temporels, et parfois même se contredit. Des personnages sans nom sont en fait des girouettes, et les animaux prennent le pas sur l’humanité. En bref, l’auteur fait fi de toutes ces contraintes raisonnables et se réjouit de perdre le lecteur dans un labyrinthe de poésie insensée. Mais Chevillard n’abandonne pas toute logique pour autant : au travers des écrits de Novat, le narrateur suit une trame réfléchie.
Certes, le texte évolue, capricieux, changeant, parfois tordu. Et oui, les sauts de lignes au bout de trois phrases ou deux mots semblent parfois excessifs. La construction du roman se distingue en réalité par une originalité calculée. Les dispersions du narrateur, l’air de rien, mènent à des thématiques subtiles, qui poussent à la réflexion, en une sorte de roman-tiroir. On comprend ainsi qu’au travers de cette obsession pour Louis-Constantin Novat, auteur inconnu de son « vivant », le personnage entretient un rapport complexe à la postérité. Une sorte de quête l’obnubile : faire connaître au grand public les manuscrits de Novat, en les remaniant légèrement pour les faire passer comme siens. Ce rapport à la postérité interroge, remet en question les critères qui forgent la « qualité littéraire ». Et parmi eux, celui qui paraît évident : la critique. Elle fait le lien entre un auteur et son public, entre un écrivain et le monde littéraire dans lequel il évolue. Et ce lien conditionne la renommée.

La relation entre critique et postérité intéresse particulièrement l’auteur, comme en témoigne un de ses ouvrages précédents, Démolir Nisard. Cette œuvre s’apparente à une diatribe contre un critique conservateur du XIXe siècle, empreinte d’une fureur parfois comique. L’écrivain révèle la relation tendue qui peut exister entre un auteur et la critique, ainsi que le rôle primordial de cette dernière dans sa carrière. Cette tension existe aussi dans L’explosion de la tortue, de deux façons : dans le style comme dans l’histoire. Chevillard possède une écriture particulière. Elle le définit et le détache d’une littérature plus « classique », qu’il peut ainsi critiquer. Il joue avec les codes et avec le lecteur, se moque de lui, le taquine. Et il se fait critiquer pour cela, mais cela lui plaît : il revendique cette indépendance ! Sa renommée lui permet de se faire entendre et de remettre en question le concept même du roman. Novat, lui, n’a jamais été lu. Sans le narrateur (et donc Chevillard), ses histoires n’auraient jamais été publiées, ses romans, jamais lus. La critique offre de la visibilité et, qu’elle soit bonne ou mauvaise, permet une certaine postérité. Mais en son absence, des génies peuvent rester dans l’ombre, se révélant quelques siècles plus tard.
Lorsque le narrateur décrit le dernier manuscrit de Novat, on ne saisit pas tout de suite sa portée. Une escroquerie bien menée, un benêt qui se ruine pour une postérité vraisemblablement jamais acquise, bon. Mais en apprenant que la famille de Novat a elle-même cru en cette « Agence » au point de laisser de l’argent avec les manuscrits, un déclic se produit. Le cerveau s’active, car il comprend enfin quelque chose. Le narrateur a donc été payé pour rééditer Novat, pour lui offrir une renommée bien méritée. Mais l’histoire de cette tortue ressemble étrangement à celle du lézard. Tiens ?
Ainsi, la frontière entre invention et réalité s’estompe dangereusement. Ce qu’on pensait n’être qu’une anecdote parmi tant d’autres devient la clef qui permet de comprendre chaque élément dispersé du roman. Le lien entre l’ouvrage de Chevillard et celui de Novat surprend car il replace dans le réel une problématique fictive. La confusion des deux auteurs paraît improbable et pourtant logique, inévitable. La distinction entre fiction et réalité perd de son imperméabilité, ce qui permet à Chevillard d’atteindre le lecteur et de le faire réfléchir sur les enjeux de la littérature.
Une fois le livre refermé, l’affaire s’avère plus floue que jamais. On demeure perplexe, comme noyé par un flot ininterrompu de questions ou d’hypothèses, submergé en quelque sorte par un roman provocateur et inqualifiable. Malgré la confusion, on comprend que ce n’est qu’un jeu dont on doit trouver le sens. Un défi intellectuel qui permet au lecteur de prendre de la distance. Un roman dans le roman qui excède la simple manœuvre littéraire, mais interroge le rapport qu’entretient un auteur à son œuvre, à la critique. Et ici, le rapport spécifique d’Éric Chevillard à un roman qui n’en est pas un.

