par Carla Dabadie
Le troisième roman de Joël Casséus déconcerte. Les voix de huit personnages sans identité, réfugiés dans un bidonville, se succèdent, offrant un regard panoramique sur l’inexorabilité et l’injustice de leur condition. En dénonçant le sort de ces réfugiés, il signe un roman poignant.
Joël Casséus, Crépuscules. Le Tripode, 155 p., 16 €
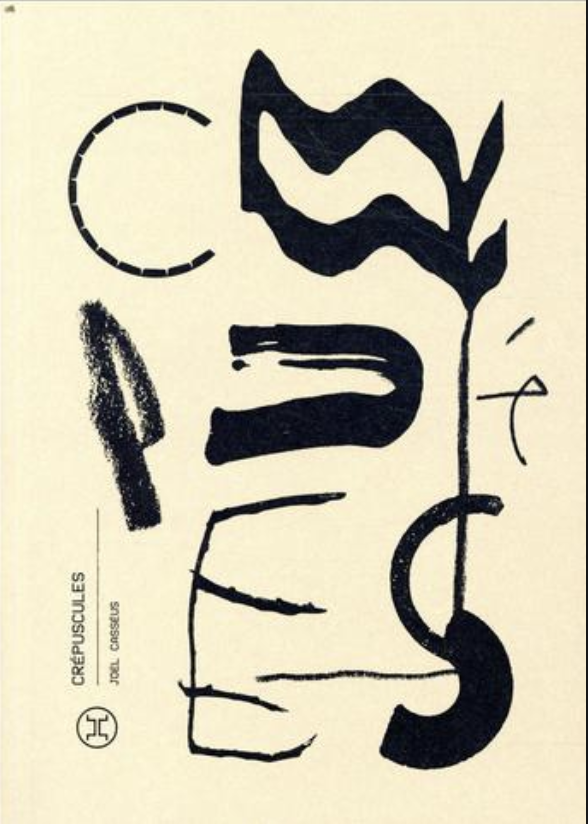
Joël Casséus nous dévoile, dans un texte étonnant, un monde inhumain où les individus sont exclus, parqués, relégués. Dans Crépuscules, on découvre huit de ces personnages exemplaires, êtres délaissés, en marge de la société, à qui l’on ne donne ni visage, ni nom, à l’exception de quelques attributs glanés au fil des pages, comme au hasard : un iris brisé, un ventre portant un enfant ou un alcoolisme latent. On découvre ainsi un couple de marchands, citoyens rongés par l’ennui et la peur, aux côtés d’une famille détruite par l’alcoolisme et dont les jumeaux sont les victimes. L’arrivée d’une femme enceinte, citoyenne, et de son mari, clandestin, deux êtres tourmentés par le « blasphème de leur union » bouleverse leur quotidien. Tous portent les stigmates de cette guerre, cicatrices visibles qui deviennent le miroir des blessures intérieures. Réunis par le hasard, ils semblent symboliser la communauté éparse des sans-papiers, migrants, réfugiés ou clandestins. N’étant ni située dans le temps ni dans l’espace, la zone de guerre que l’on visite, recueillant des âmes échouées, devient ainsi universelle. Les voix se mêlent pour porter le témoignage des errances de ces êtres sans nation ni identité. Casséus assemble des discours enchevêtrés, formant pourtant un ensemble homogène, sorte de palimpseste estompé, et les voix semblent porter le même message : dénoncer l’injustice de la condition des réfugiés.
Dans un environnement hostile dont on ne connait pas les frontières, sorte de terrain vague désolé ou de bidonville sordide, les clandestins survivent dans des wagons abandonnés. Pourtant, ils ne parviennent pas à former une communauté unie, dont il résulte un climat ambiant de peur et de suspicion. Plongés dans une guerre sans ennemi ni fin, ils luttent : contre le désespoir, la déshumanisation ou la mort. Condamnés à vivre dans un monde où les enfants deviennent soldats et où les vrombissements des drones ne font jamais oublier que la guerre fait rage quelque part, ils livrent une résistance passive, survivant coûte que coûte. Au sein de ce semblant de village qu’ils ont recréé, à proximité d’un état sans loi mis à part celle de la guerre, ils évoluent dans un huis clos à ciel ouvert. Victimes d’une situation imposée par une société intolérante, coupables d’être mal nés ou mal avisés, ils sont relégués au ban de la civilisation. Ainsi, les jumeaux sont nés et condamnés à demeurer dans ce bidonville, alors que la future mère, née citoyenne, a sciemment décidé de son sort en suivant un sans-papiers. En collectant des déchets, ces « déjections de la guerre », afin de les revendre aux usines voisines pour subsister, ils deviennent les instruments de leur propre destruction. Pris dans ce cercle vicieux, les personnages végètent, les jours se succèdent, avec une morosité qui estompe la notion du temps. Les personnages semblent faiblir sans toutefois renoncer totalement à perdre espoir : espoir symbolisé par l’enfant à naître, dont la rage de vivre sera déterminante pour sa survie. Tel une parabole, le texte, véritable transposition du réel, nous fait réexaminer la situation actuelle des crises migratoires et leurs conséquences. Symbolique par essence, il s’applique à la totalité des phénomènes migratoires passés et futurs, se fait emblème des victimes de ces exodes forcés.

Casséus décrit un paysage stérile où les hommes eux-mêmes mettent l’humanité en péril. Plongés au sein d’une sorte de purgatoire, les personnages stagnent, sous la menace permanente de la guerre, épée de Damoclès qui les surplombe inéluctablement. L’oubli les guette ; ils demeurent des êtres anonymes, flous, évanescents, presque déjà disparus. Leur croisade pour la vie semble impossible à gagner, la mort et l’effacement la seule conclusion possible. Pris au piège, les hommes perdent leur humanité, guettés par une bête qui terrorise le campement. La bête rode dans les bois et s’attaque aux plus vulnérables, rendue plus monstrueuse encore par sa ressemblance avec eux. « Je ne perçois plus la frontière nécessaire entre ce qu’elle est et ce que nous sommes censés représenter. […] Je comprends que la frontière entre les bêtes et l’humanité précaire était si fragile qu’un simple crépuscule pouvait y mettre fin », témoigne la femme enceinte avec un calme troublant lors de l’attaque de la créature. Les dernières lueurs avant la nuit, quand le ciel s’embrase avant de s’enténébrer, symbolisent les dernières notes d’espoir avant la désillusion totale et le dégoût existentiel. Les personnages, presque abouliques, résignés, en viennent ainsi à regretter la mort : « jusqu’à ce que tu te fatigues du monde et que tu ne veuilles que mourir. Un jour le soleil qui se lève te rappelle toujours les crépuscules. Alors tu te dis qu’il te reste encore plusieurs minutes, quelques heures avant que le soleil se couche. Puis tu finis par essayer d’arrêter de souffrir », soupire le propriétaire du « dépensoir ».
La fiction devient donc moyen de résistance ; l’illusion représente l’ultime échappatoire. Vivre dans le passé devient le seul subterfuge possible pour échapper au présent, songer au futur, la seule parade pour esquiver les souffrances immédiates. L’imaginaire, incontrôlable, sauve donc. Dans les souvenirs et les songes résident les singularités, les identités effacées par la guerre ressurgissent, l’uniformité s’estompe devant la multiplicité des expériences et des sentiments. Les passés se dévoilent progressivement : on découvre donc les pérégrinations de la femme enceinte et de son mari qui évoquent leur fuite, leur séjour au bord de la mer dont le ressac semble encore les bercer aujourd’hui, tandis que le père de famille témoigne de son passé de bâtisseur, de sa grandeur évanouie, dont il ne résulte rien. Ces anecdotes suintent la mélancolie et les remords lourds, et semble oblitérer le futur. Tous maudissent leur situation qui, initialement provisoire, s’avère permanente. Seule la future mère s’accroche à l’espoir que représente son enfant : sera-t-il considéré comme citoyen ou bien banni comme le sont les jumeaux ? Alors que le futur de l’enfant à naître questionne toute la communauté, on assiste en parallèle à la chute des jumeaux : frôlant la bestialité monstrueuse, ils abolissent leur innocence et finissent par se faire aussi sombres que le no man’s land désolé dans lequel ils s’échinent à survivre.

Les voix égarées s’entrecroisent, partagent leurs témoignages, conforment une surprenante polyphonie. Ces alternances fréquentes permettent finalement de saisir tout le spectre d’émotions et de ressentis que confient les personnages. L’omniprésence sentiments les humanise : si leurs réactions semblent à la fois bestiales, obéissant à une logique de survie, elles demeurent profondément humaines. Sortes de dialogues intérieurs partagés avec le lecteur, elles se singularisent pourtant d’évidence. Si le roman incarne la communauté dans son intégralité, une voix correspond à chaque individu, distincte, autonome, et pourtant reliée à un tout qui l’englobe. La forme du roman se transmue en allégorie du combat interdit : celui d’une communauté, mais avant tout de chaque victime qui la compose. L’originalité du texte charme, son harmonie et ses sonorités l’homogénéisent. La pluralité et la continuité des discours forment ainsi un manifeste dénonciateur, virulent, radical, qui s’inscrit à la croisée du roman social et de l’anticipation. On plonge dans cet univers dystopique dont Casséus maîtrise tous les codes, en jouant à l’envi. On y retrouve tous les schèmes du genre : une société contrôlée, policière, une guerre et une violence omniprésentes, une distinction extrême des individus, une hiérarchisation de l’humain… Joël Casséus déploie un lexique nouveau, sorte de novlanguemonstrueuse. Le lecteur navigue entre le « dépensoir » et la décharge, tente de sentir le goût du « pemican » et observe les femmes boire leur « chicoclorophylle »… comme s’il était à leur côté… La langue agit alors comme un miroir déformant, ancrant le roman dans une irréalité terrifiante dans laquelle tout se reconnaît, distordant le réel, faisant du langage l’espace premier d’une dénonciation de la violence totalitaire.
Polyphonique, original, sensible, Crépuscules dénonce les dérives d’une société égocentrée et le sort de ses laissés-pour-compte qu’elle rejette à ses marges. Dans un monde où l’espoir s’étiole, où la seule fuite possible réside dans le rêve ou dans la mort, les huit personnages nous confient leurs témoignages, pour qu’ils ne s’abolissent pas totalement. Allégorie de la situation des réfugiés, pamphlet contre l’individualisme et le despotisme, aux confluences du réel et de l’anticipation, le roman déstabilise. Les huit voix se mêlent, témoignent, dénoncent, palimpseste édifiant qui transforme l’unicité en totalité. Dans un contexte actuel troublé par les crises migratoires, cette fable féroce nous alarme et nous éveille.

